Le Mouridisme
Historique

L'Historique
L'adoration de Dieu est la raison principale de la fondation de la ville de Touba en 1888 par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Cette ville, située dans la région de Diourbel et à 194 km à l'Est de Dakar, est l'aboutissement d'un périple de Bamba, qui a duré de 1883 à 1886 entre Mbacké Cayor, Mbacké Baol et Darou Salam. En effet, les déplacements du Cheikh étaient motivés par une volonté de fuir les foules pour se consacrer uniquement à l'adoration de Dieu et être au service du Prophète Mohamed (PSL).
Le mouridisme ou Mouridiyya est une confrérie soufie, la deuxième à pénétrer au Sénégal après la Tijaniyya où, avec la Gambie, elle est presque exclusivement implantée. Cette confrérie est fondée à la fin du XIXe siècle par Cheikh Ahmadou Bamba et joue un rôle religieux, économique et politique de premier plan au Sénégal.
La tradition mouride est fortement marquée par la culture islamique. Les fidèles effectuent un pèlerinage annuel dans la ville sainte de Touba, au centre du Sénégal, le Magal, qui commémore le départ en exil, en 1895, du Cheikh Ahmadou Bamba sous la pression de l'autorité coloniale française.
Sa doctrine repose sur quatre principes fondamentaux : la foi en Dieu, l'imitation du Prophète Mohammed, l'apprentissage du Coran et l'amour du travail. Les Mourides assimilent à l'islam des traditions propres au peuple wolof, ce qui est le cas de la sanctification du travail, ou encore leur attachement très fort aux notions d'entraide et de solidarité.
Le Fondateur

Cheikh Ahmadou Bamba
Né à Mbacké-Baol, ville fondée par son arrière-grand-père Maharame Mbacké dans le royaume de Baol, fils du marabout de la confrérie de Xaadir – la plus ancienne du Sénégal – Mame Momar Anta Sali Mbacké, et de Mame Diarra Bousso, Ahmadou Bamba est un musulman soufi ascétique et mystique qui écrivait sur la méditation, les rituels et les études coraniques.
Il prêche avec succès la paix et promet le salut à ses disciples qui se seraient conformés à ses recommandations qui sont celles de Dieu et de son prophète dans l'islam Mahomet. Il fonde la ville de Touba (Sénégal) en 1887. Il est arrêté par les autorités coloniales, qui l'enferment dans la prison de Saint-Louis, siège du gouverneur de l'AOF (Afrique occidentale française), avant de l'envoyer en exil, en 1895, au Gabon.
Après 1910, les autorités françaises réalisent que Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine de Bamba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Son mouvement prit de l'ampleur en 1926 quand la construction de la Grande Mosquée de Touba, où il est inhumé, commença. Son tombeau est un lieu de pèlerinage.
Les Khalifes
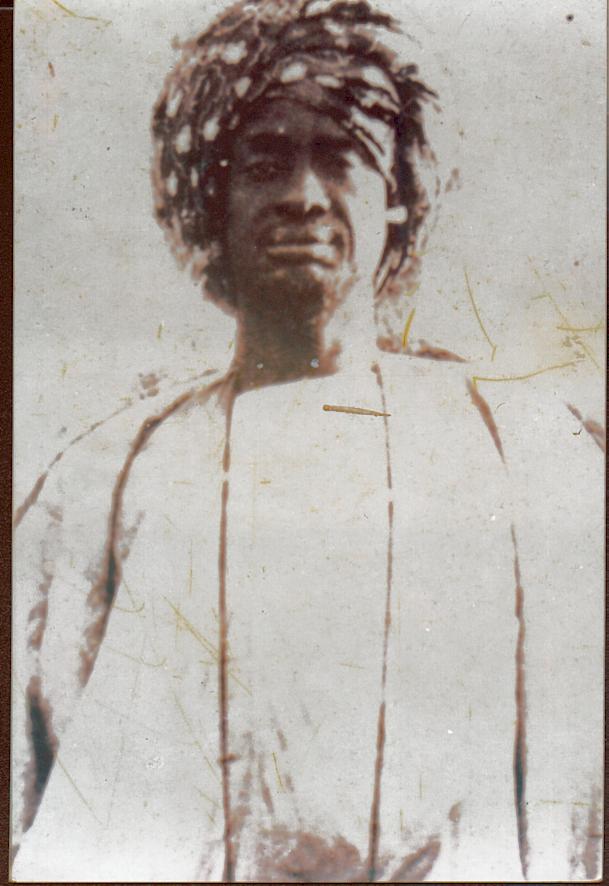
Serigne Modou Moustapha Mbacké
Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, né en 1888 à Darou Salam et mort le 13 juillet 1945 à Touba est un chef religieux musulman, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et premier khalife de la confrérie mouride. Après la disparition de son père le 19 juillet 1927, il devient officiellement premier calife des Mourides le 25 juillet 1927. Il s'attaque ensuite à la construction de la Grande Mosquée de Touba qui était l'une des dernières volontés de son père.

Serigne Fallou Mbacké
Serigne Mouhamadou Fadl Mbacké, né le 27 juin 1888 à Darou Salam et mort le 6 août 1968 à Touba, est un dignitaire religieux musulman sénégalais. Il est le deuxième calife des mourides de 1945 jusqu'à sa mort en 1968. Sous son leadership, il s'attèle vigoureusement à la construction de la grande mosquée de Touba, qu'il inaugure le 7 juin 1963.

Serigne Abdoul Ahad Mbacké
Cheikh Abdoul Ahad Mbacké est né en 1914 à Diourbel. Il est le fils de cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme et de Sokhna Mariama Diakhaté. Il devient le troisième khalife général des mourides en succédant à son frère aîné Serigne Fallou Mbacké en 1968. Sous son khalifat, Touba a connu une expansion fulgurante et la cité bénite de Khadimou Rassoul accède aux infrastructures modernes.
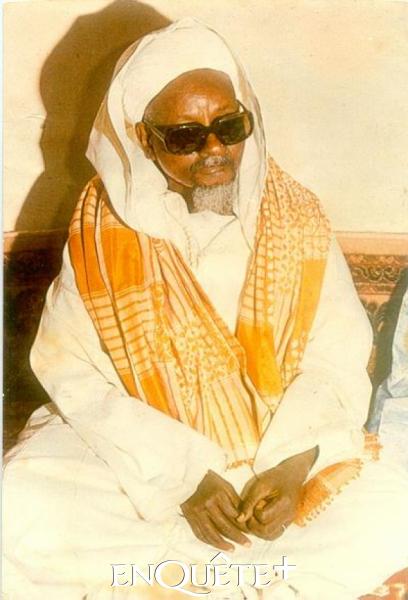
Serigne Abdou Khadre Mbacké
Serigne Abdoul Khadre Mbacké a connu le califat le plus bref de l'histoire du mouridisme ; il ne sera en charge des affaires de la communauté en tant que calife que du 19 juin 1989 au 13 mai 1990. Ses qualités d'homme de Dieu avérées et sa dévotion à l'islam et à la cause du mouridisme lui vaudront le respect et l'estime de la postérité, toutes confessions confondues.
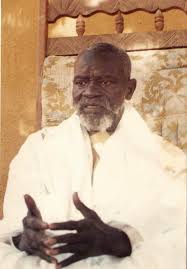
Serigne Saliou Mbacké
Serigne Saliou Mbacké, né à Diourbel le 22 septembre 1915 et décédé à Touba le 28 décembre 2007, est une personnalité religieuse du Sénégal. Il est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du Mouridisme. Il est le 5e khalife des mourides entre 1990 et 2007 et bénéficie, à ce titre, d'une grande aura dans cette communauté, au Sénégal.

Serigne Bara Mbacké
Il est des destins qui semblent tissés dès l'aube de la vie dans les fils d'une mission spirituelle. Celui de Serigne Mouhammadou Lamine Bara Mbacké, né en 1921 à Touba, appartient à cette lignée rare où le service de Dieu et la fidélité à l'œuvre d'un saint se mêlent intimement. Le 28 décembre 2007, à l'âge de 82 ans, il fut désigné sixième Khalife général des Mourides, succédant à Serigne Saliou Mbacké.
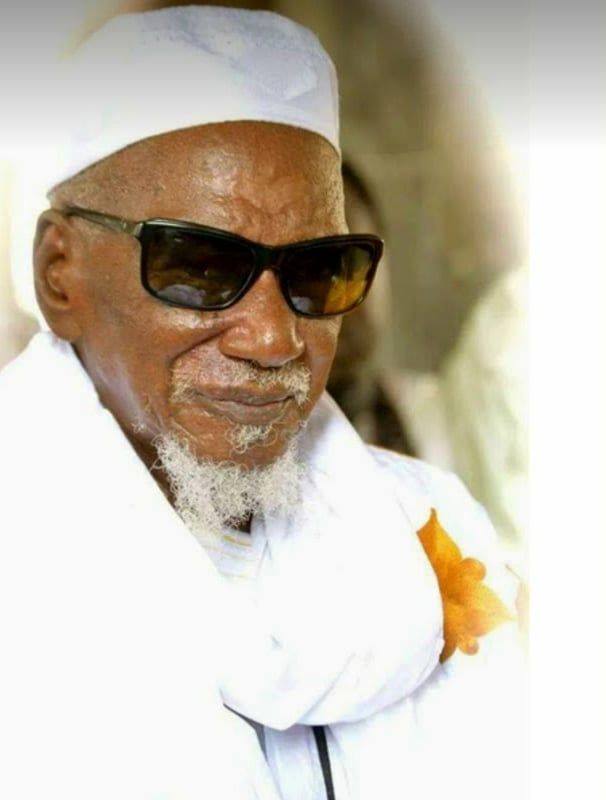
Serigne Sidy Moukhtar Mbacké
Il est des hommes dont la naissance est déjà une réponse à un appel céleste. Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, connu affectueusement comme Serigne Cheikh Maty Lèye, vit le jour un 15ᵉ jour béni de Ramadan, vers 1924, à Mbacké Kadior. Le 1ᵉʳ juillet 2010, le destin l'éleva à la plus haute fonction : 7ᵉ khalife général des mourides et premier à cumuler cette dignité avec celle de khalife de Darou Khoudoss et de Gouye Mbind.

Serigne Mountakha Mbacké
Serigne Mountakha Mbacké est né le 11 juillet 1932 à Darou Miname, au Sénégal. Il est le fils de Serigne Bassirou Mbacké et de sokhna Bineta Diakhaté. En janvier 2018, à la suite du décès de Serigne Sidi Moukhtar Mbacké, Serigne Mountakha Mbacké a été nommé Khalife général des Mourides. Sous sa direction, la confrérie Mouride a continué de croître et de prospérer.